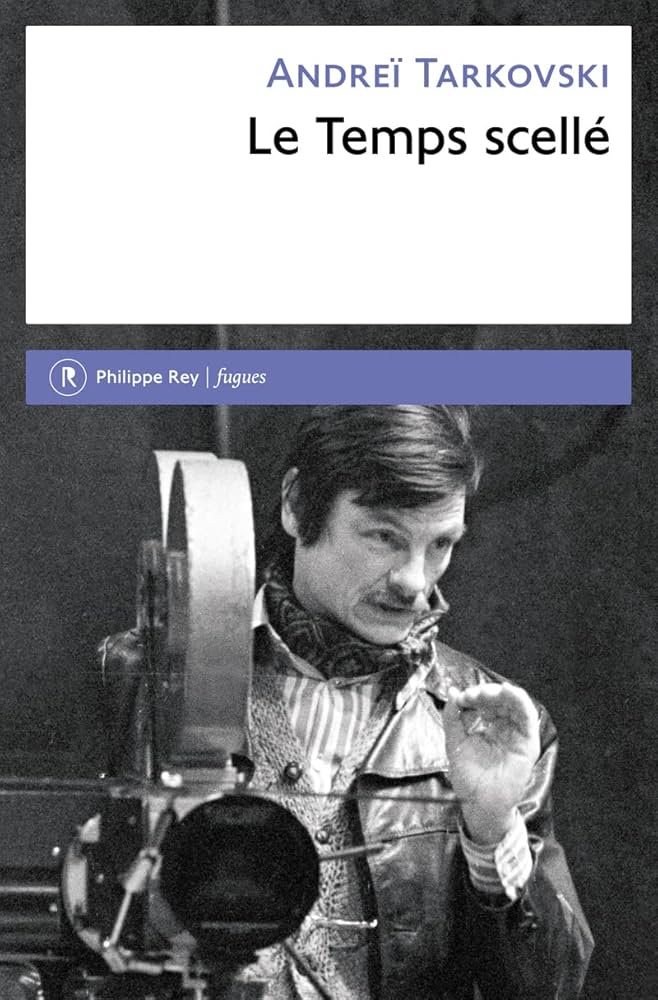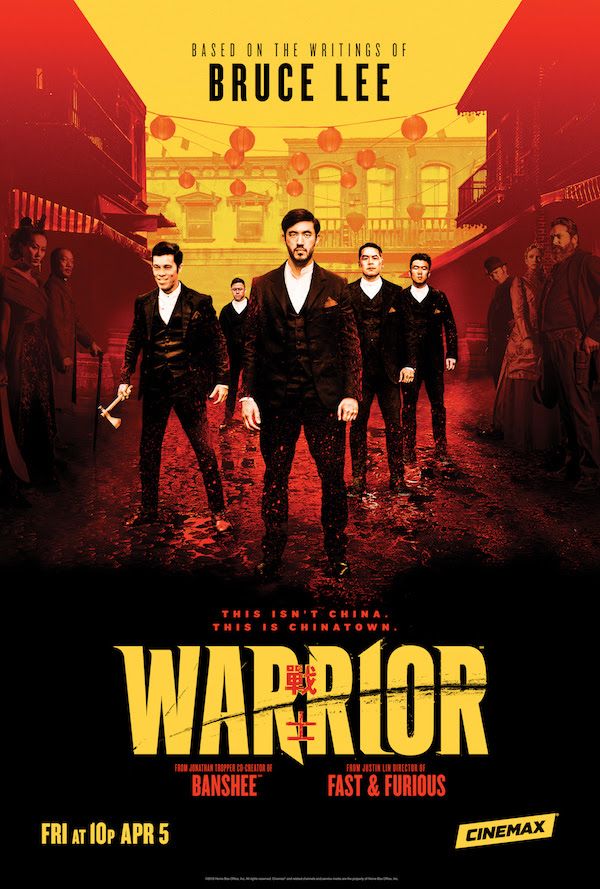
« Warrior », cette série américaine diffusée entre 2019 et 2023, tire son inspiration des écrits et concepts du légendaire Bruce Lee, imaginés à l’origine comme un projet personnel pour l’icône des arts martiaux. Transportant le spectateur dans le San Francisco bouillonnant des années 1870, une ère marquée par la ruée vers l’or, l’immigration massive et les tensions raciales explosives, la série promet un cocktail détonant d’action brutale, de drames humains et d’intrigues mafieuses. À première vue, elle a tous les ingrédients d’un blockbuster télévisuel : des chorégraphies de combats dignes des plus grands films de kung-fu, une reconstitution historique immersive des quartiers chinois de la ville, et une galerie de personnages qui, au début, semblent taillés pour captiver. Produite initialement par Cinemax puis reprise par HBO Max (et plus tard Netflix pour une diffusion plus large), « Warrior » s’appuie sur un budget solide pour offrir des visuels impressionnants, avec des décors qui recréent fidèlement l’atmosphère chaotique de Chinatown, ses ruelles sombres, ses tripots enfumés et ses bagarres de rue impitoyables.
Dès les premiers épisodes de la saison 1, on est happé par l’énergie brute de l’ensemble. Le protagoniste principal, Ah Sahm, interprété avec charisme par Andrew Koji, débarque en Amérique comme un immigrant chinois fuyant un passé trouble. Expert en arts martiaux, il ne tarde pas à se faire remarquer par ses prouesses au combat, intégrant rapidement les rangs d’un tong (un gang chinois) puissant. Les scènes d’action sont un véritable feu d’artifice : chorégraphiées avec une précision chirurgicale (on pense à des influences comme « Ip Man » ou les films de Jackie Chan), elles mêlent coups de poing fulgurants, acrobaties aériennes et une violence crue qui colle parfaitement à l’époque. Imaginez des duels où chaque impact résonne comme un coup de tonnerre, filmés avec des plans dynamiques qui capturent la sueur, le sang et l’intensité des affrontements. C’est là que « Warrior » excelle : elle ne se contente pas de montrer des bagarres gratuites, mais les intègre à une narration qui explore les dynamiques de pouvoir au sein des communautés immigrées.
Au-delà de l’action, la saison 1 pose des bases thématiques solides et nuancées. L’immigration est au cœur du récit : Ah Sahm et ses compatriotes chinois font face à une Amérique hostile, où la loi anti-immigration comme le Chinese Exclusion Act (bien que légèrement anachronique, car il date de 1882, mais l’esprit est là) plane comme une ombre menaçante. Le racisme ambiant est dépeint sans fard – insultes, discriminations, violences policières – mais avec une subtilité qui évite le manichéisme. On voit des personnages comme Mai Ling (Dianne Doan), une femme ambitieuse et manipulatrice, naviguer dans ce monde patriarcal avec intelligence, ou encore Leary (Dean Jagger), un leader ouvrier irlandais raciste mais humain dans ses motivations économiques. La survie dans cet univers impitoyable est un thème récurrent : alliances fragiles entre gangs, trahisons internes, et la quête d’identité dans un pays qui vous rejette. Tout cela est servi par un rythme haletant, des dialogues vifs et une bande-son qui pulse au rythme des combats. On devient vite addictif, binge-watching les épisodes en se disant que voilà une série qui pourrait rivaliser avec des classiques comme « Peaky Blinders » ou « Boardwalk Empire », mais avec une saveur orientale unique. Les critiques initiales, d’ailleurs, saluaient cette fraîcheur, et la série a même été renouvelée grâce à un bouche-à-oreille enthousiaste.
Pourtant, ce qui commence comme une promesse d’excellence se mue progressivement en une déception amère. Dès la fin de la saison 1, on perçoit des signes avant-coureurs, mais c’est véritablement à partir de la saison 2 que l’agenda woke s’impose avec une lourdeur qui frise l’insupportable. Ce qui était une critique sociale intégrée organiquement à l’intrigue devient un prêchi-prêcha constant, comme si les scénaristes, menés par Jonathan Tropper (connu pour « Banshee »), avaient subitement cédé à une pression idéologique venue d’Hollywood. La subtilité des thèmes initiaux – racisme, immigration, inégalités – est remplacée par une checklist progressiste forcée : diversité ethnique surreprésentée de manière anachronique (dans un San Francisco des années 1870 où les interactions interraciales étaient rares et conflictuelles), discours anti-patriarcaux martelés à chaque opportunité, et une victimisation exacerbée des minorités qui transforme les personnages en porte-étendards plutôt qu’en êtres complexes.
Prenons les personnages féminins, par exemple. Dans la saison 1, des figures comme Ah Toy (Olivia Cheng), une tenancière de bordel rusée et impitoyable, ou Mai Ling, avec ses ambitions machiavéliques, offraient une profondeur fascinante : elles étaient fortes, oui, mais avec des failles, des motivations égoïstes et une vulnérabilité qui les rendait humaines. Dès la saison 2, elles mutent en archétypes de « strong independent women » invincibles, capables de terrasser des hordes d’hommes armés sans une égratignure, au mépris de toute crédibilité historique ou physique. C’est comme si les scénaristes avaient peur d’offenser quiconque en montrant des femmes faillibles ; au lieu de cela, elles deviennent des super-héroïnes anachroniques, prêchant l’empowerment féministe dans un contexte où de tels concepts n’existaient tout simplement pas. Les dialogues s’alourdissent de sermons sur l’équité de genre, l’inclusion et la sororité, qui sonnent faux dans la bouche de personnages du XIXe siècle. On en vient à rouler des yeux à chaque fois qu’une femme prend la parole, non pas parce que le message est mauvais en soi, mais parce qu’il est imposé avec une telle maladresse qu’il brise l’immersion.
Les intrigues subissent le même sort. L’action pure, qui faisait le sel de la série, est diluée par des sous-intrigues moralisatrices. Les guerres de gangs, autrefois centrées sur la survie et le pouvoir, deviennent des allégories contemporaines sur la justice sociale : on voit des alliances improbables basées sur des idéaux d’égalité, des critiques explicites du capitalisme (présenté comme l’ennemi ultime), et une réécriture de l’histoire pour coller à des narratifs modernes. Par exemple, le racisme anti-chinois, bien réel à l’époque, est amplifié au point de rendre tous les personnages blancs des caricatures de suprémacistes, sans nuance ni exploration des contextes socio-économiques (comme la concurrence pour les emplois entre immigrants chinois et irlandais). C’est une victimisation exacerbée qui ignore les complexités historiques – les Chinois eux-mêmes n’étaient pas exempts de divisions internes ou de violences – pour servir un message binaire : opprimés vs oppresseurs. Les épisodes se transforment en leçons de morale, avec des monologues interminables qui stoppent net le rythme, sacrifiant l’intrigue au profit d’un prosélytisme qui transpire à chaque plan.
La saison 3 pousse ces travers à l’extrême, rendant la série outright indigeste. Au lieu de corriger le tir, les scénaristes doublent la mise : plus de diversité forcée (introduisant des personnages LGBTQ+ dans un contexte historique où cela serait hautement improbable sans exploration sérieuse), plus de discours sur l’intersectionnalité, et une peur palpable de « froisser » les sensibilités modernes. Les combats, autrefois épiques, deviennent secondaires, relégués à des interludes entre deux sermons. Ah Sahm, qui était un anti-héros nuancé, se mue en porte-parole woke, perdant son charisme au profit d’une rectitude morale impeccable. C’est comme si « Warrior » avait retourné sa jaquette, passant d’une série d’action historique à un véhicule propagandiste pour les idéaux progressistes d’Hollywood. On pense à d’autres séries qui ont subi le même sort, comme « The Witcher » ou « Rings of Power », où l’idéologie prime sur la cohérence narrative, aliénant une partie du public au nom d’une inclusivité maladroite.
En fin de compte, « Warrior » illustre parfaitement comment l’Amérique contemporaine utilise son soft-power – cinéma, séries, médias – pour diffuser une idéologie dominante, au détriment de l’art pur. Ce qui aurait pu être une œuvre marquante, honorant l’héritage de Bruce Lee avec authenticité, se saborde en une leçon de morale imposée. Une punition méritée : 1/10. Si vous cherchez de l’action historique sans agenda, tournez-vous plutôt vers des classiques comme « Deadwood » ou des films de kung-fu old-school. « Warrior » ? Passez votre chemin, à moins d’aimer les prêches déguisés en divertissement.